Dans leur dernière publication, Sophie Javerzat, chercheuse à l’unité MRGM (Inserm U1211, université de Bordeaux), et ses collègues s’intéressent à un mécanisme encore peu exploré : la vulnérabilité au saut de l’exon 10 du gène humain OCA2, dont la modulation pourrait expliquer certaines formes d’albinisme, mais aussi la diversité naturelle de la couleur de la peau, des yeux et des cheveux.
Au-delà de la peau : une maladie qui touche aussi la vision
Maladie génétique rare, l’albinisme reste pourtant mieux connu du grand public que bien d’autres pathologies. « Quand on interroge les gens, ils savent généralement que les personnes atteintes ont la peau, les cheveux et les yeux très clairs ; ils ont souvent vu des images d’animaux albinos comme la souris. L’albinisme peut se manifester chez tous les Vertébrés », explique Sophie Javerzat.
Mais au-delà de ces différences visibles, le trouble touche aussi la vision. « Tous les patients, sans exception, présentent des atteintes ophtalmologiques liées à un défaut de pigmentation de la rétine », précise-t-elle.
Des patients au laboratoire : une recherche collaborative
À Bordeaux, la recherche et la clinique avancent main dans la main. L’équipe du MRGM collabore étroitement avec le laboratoire de diagnostic moléculaire du CHU, où sont suivis la plupart des patients français atteints d’albinisme.
« Bordeaux centralise la base de données génétique et clinique de la cohorte nationale, soit plus de 3.000 patients, rappelle Sophie Javerzat. Parmi eux, environ 30 % restent en errance diagnostique ; on ne parvient pas encore à identifier le gène responsable. »
Dans ce travail, les chercheurs se sont concentrés sur une forme fréquente d’albinisme, dite oculocutanée de type 2 (OCA2). Ce type d’albinisme résulte d’altérations dans le gène OCA2, impliqué dans la production de la mélanine. « Ce gène code une protéine qui régule le pH des petites usines à pigment, les mélanosomes. Si la protéine ne fonctionne pas, la chaîne de fabrication est interrompue et le pigment ne se forme pas », résume-t-elle.
Un mécanisme subtil au cœur du gène OCA2
En étudiant des patients porteurs d’un seul variant connu pour être pathogène dans le gène OCA2, les chercheurs ont remarqué la présence fréquente d’un variant rare de signification inconnue sur la deuxième copie du gène. « Nombre de ces patients présentaient des altérations dans une même région du gène, sans qu’on comprenne leur effet », indique la chercheuse.
L’équipe découvre alors un mécanisme insoupçonné : ces variations perturbent le processus d’épissage, une étape clé de la transcription du gène. « Elles favorisent ce qu’on appelle le saut de l’exon 10, une portion de la séquence disparaît de l’ARN. Résultat : la protéine fonctionnelle n’est plus fabriquée et la maladie se déclare. »
De la maladie à la diversité humaine
Pour aller plus loin, les chercheurs ont élargi leur étude à des données de populations variées, en collaboration avec leurs partenaires britanniques à Manchester. Ils ont montré que ce même mécanisme, lorsqu’il reste modéré, est associé à la variabilité naturelle de la couleur de la peau et des cheveux.
« En Afrique, les séquences du gène sont stabilisées pour limiter le saut d’exon, tandis qu’en Europe, certaines variations favorisent une peau plus claire », explique Sophie Javerzat.
Ces résultats dépassent le cadre de la pathologie : ils éclairent aussi sur l’évolution du génome humain et les adaptations de notre espèce à l’environnement, en particulier l’exposition aux UV.
Prochaine étape : explorer le lien entre pigmentation et vision
La prochaine étape portera sur la vision. L’équipe bordelaise souhaite analyser les paramètres rétiniens pour comprendre comment les variations de l’expression du gène OCA2 influencent le développement de la rétine.
« Ce qui affecte la pigmentation affecte aussi la vision, rappelle Sophie Javerzat. Comprendre ces mécanismes, c’est avancer vers une meilleure prise en charge et, peut-être un jour, vers des approches thérapeutiques ciblées. »
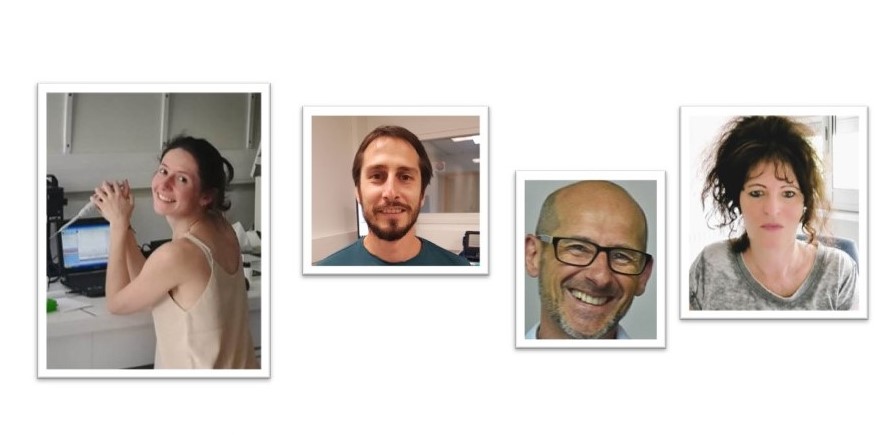
Elina Mercier - expérimentatrice principale -, Vincent Michaud, Benoît Arveiler, Sophie Javerzat
Interview réalisée par Hande Sena Kandemir, sous validation scientifique de Béatrice Turcq.
Crédits photo - Canva


